
En Nouvelle-Calédonie, la SCI peut être familiale : elle permet aux membres d’une même famille d’être propriétaires, dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial.
Les statuts régissent le fonctionnement de la SCI. Ils doivent impérativement être rédigés par écrit par un professionnel du droit (notaire ou juriste).
Leur rédaction est assez libre, mais il est important d’y insérer certaines clauses relatives par exemple à l’étendue du mandat du gérant, aux règles de majorités lors des votes des assemblées, de limiter parfois le droit de vote aux seuls parents, de prévoir une réglementation spécifique en cas de vente ou échange de parts, de prévoir des agréments en cas d’entrée dans la société ou de sortie…
La SCI ne peut pas exercer une activité commerciale à titre principal (par ex location en meublé ou achat à titre habituel de biens immobiliers en vue de leur revente).
⚠ Attention : un mineur peut être associé avec l’accord de ses représentants (ses parents). En revanche, en cas de vente d’un bien appartenant à la SCI, il y aura lieu de prévoir l’intervention du juge pour donner l’autorisation.
Les apports déterminent les droits des associés dans le capital social.
Après leur signature, les statuts seront enregistrés à la Direction des Services Fiscaux. Ils feront également l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales et d’une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le gérant :
Le gérant peut être associé ou non de la SCI.
Il représente la société et il l’engage dans la limite de l’objet social. Ce sont les associés qui déterminent les pouvoirs du gérant dans les statuts.
Les associés :
A défaut d’indication dans les statuts, les droits des associés sont proportionnels aux parts possédées dans le capital social.
En contrepartie de ces droits, les associés sont tenus, à l’égard des tiers, au passif social, indéfiniment et proportionnellement à leurs droits dans le capital.
Ainsi, l’associé qui aura investi 40% du capital social et qui aura droit à 40% des distributions de dividendes, sera tenu de payer les charges et dettes de la SCI à hauteur de 40% du total des dettes.
⚠ Attention, la SCI doit tenir une assemblée générale annuelle.
Par ailleurs, il est conseillé de tenir une comptabilité pour permettre l’information des associés de la SCI et des services fiscaux.
Créer une SCI pour acquérir un bien présente de nombreux avantages. En autres :
Il arrive fréquemment que plusieurs personnes, qui ne l’ont pas choisi au départ, se retrouvent ensemble propriétaires d’un même bien immobilier (ex : en cas d’acquisition sous le régime de la séparation de biens, en cas de divorce ou de séparation de corps, en cas de décès…). Ce sont alors les règles de l’indivision qui s’appliquent. L’ensemble des propriétaires de l’immeuble doit alors apprendre à gérer de concert l’immeuble et s’entendre pour prendre des décisions communes. Toutefois, tout un chacun est libre de sortir de cette indivision à tout moment : cela se traduit le plus souvent par la vente dudit bien immobilier. A défaut, la mésentente s’installe et une situation de blocage se créée.
La SCI se présente comme une véritable alternative à l’indivision, beaucoup plus contraignante et source de conflits notamment entre héritiers. En effet, l’indivision nécessite l’unanimité pour les décisions les plus importantes. La SCI permet précisément d’éviter tous ces conflits dans la mesure où ce qui est fixé dans les statuts fait la loi des parties (d’où l’intérêt de bien stipuler les statuts). Les décisions sont prises en assemblée générale selon les règles de majorité définies dans les statuts.
Il est alors fortement conseillé de prévoir la constitution d’une société civile immobilière pour éviter ces dérives.
Les créanciers professionnels peuvent saisir les parts de la SCI, mais ils ne peuvent pas saisir l’immeuble qui est la propriété de la SCI.
Une SCI familiale permet de transmettre à ses enfants un patrimoine immobilier en évitant les droits de succession.
Pour cela, les parents doivent régulièrement transmettre à leurs enfants des parts de la SCI en nue-propriété.
Les parents deviennent alors usufruitiers, ils continuent ainsi à percevoir les loyers et à administrer le ou les biens immobiliers.
Au décès des parents, le droit de propriété alors démembré, redevient plein et entier, puisque les enfants récupèrent la pleine-propriété des biens immobiliers sans taxation.
La SCI peut être soumise à l’Impôt sur le Revenu (IR) ou à l’Impôt sur les Sociétés (IS).
Lorsqu’elle est soumise à l’IR, chaque associé est imposé, dans sa propre déclaration d’impôt, sur les revenus fonciers proportionnellement à ses parts dans le capital social.
Mais sur option, des associés, la SCI peut être soumise à l’IS (attention, cette option est définitive). Quand la SCI est soumise à l’IS, c’est la SCI elle-même qui paie l’impôt selon un barème légal et les bénéfices générés par la SCI sont calculés après paiement de l’IS.
En Nouvelle-Calédonie, la cession des parts sociales d’une SCI soumise à l’IS est imposée sur les plus-values mais opter pour l’IS a le gros avantage d’amortir les investissements en lien avec le bien immobilier.
Dans le cas d’une SCI à l’IS, il est obligatoire de présenter un bilan annuel.
Le cabinet se tient à votre disposition pour toute question, assistance ou demande de devis, via la page de contact.
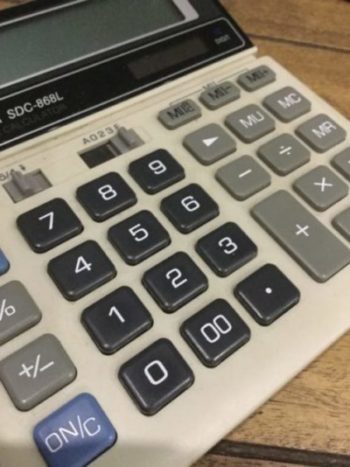
LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES SOCIÉTÉS :
Chaque entité est tenue d’établir des états de synthèse, à savoir les comptes annuels.
Les comptes annuels se composent de la sorte :
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe (Art L.123-14 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
Outre son aspect obligatoire, la tenue de documents comptable est un outil d’analyseprécieux pour l’entité qui peut avoir un suivi réel de sa santé économique et permettre de prendre des décisions quant à sa situation future.
Elle est également un gage de sureté et de confiance pour les établissements financiers et les fournisseurs mais également les clients en apportant une image fidèle du patrimoine, de la situation et du résultat de la société en question.
QUI EST CONCERNÉ PAR LA COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE ?
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.(* Pour l’application de l’article L. 123-16 relatif à l’adoption d’une présentation simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne l’annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.)
Ils perdent cette facultélorsque cette condition n’est pas remplie pendant deux exercices successifs. (Art 123-16 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
EN QUOI CONSISTE LA COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE ?
Toujours en respectant le mécanisme de la partie double, l’entité est tenue d’établir trois journaux à savoir :
De plus l’entreprise doit tenir une liste annuelle de tous ses actifs et passifs que l’on appelle inventaire.
QUELS AVANTAGES ?
LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS COMPTABLES
Le fait pour un gérant de ne pas établir les comptes annuels, un rapport de gestion et dresser un inventaire chaque année est puni d’une amende de 9 000 euros (Art L.241-4, Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
CONTACT POSSIBLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Nous vous invitons à consulter le site de l’ordre des experts comptables : http://www.oecca.nc. En effet, seuls ces derniers et les agents de comptabilité agréés peuvent effectuer à titre indépendant des prestations comptables.
La CCI dispose également de formation relative à la comptabilité des entreprises (cci(at)cci.nc, tel : 24.31.00, site internet : https://www.cci.nc)
RÉFÉRENCES ET SOURCES :
(http://www.juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdWebE.nsf/Juristart?openpage)
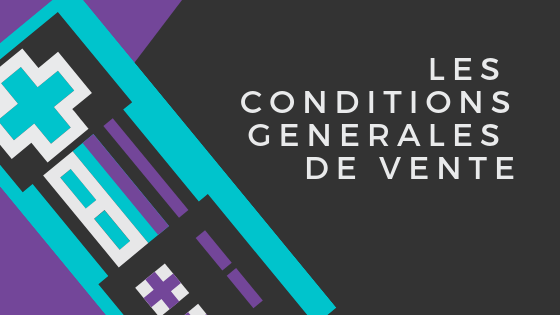
Parmi les différentes thématiques qui constituent les relations commerciales entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) représentent la première étape des négociations. Pouvant être déclinées par catégorie de clientèle, conditions catégorielles de vente (CCV) ou bien être complétées par des conditions particulières de vente (CPV), elles n’en restent pas moins indispensables pour asseoir le cadre de vos conditions de vente.
Conformément au code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, le fournisseur a donc pour obligation de les communiquer à tout acheteur ou acheteur potentiel, qui en fait la demande, sous peine d’être sanctionné.
Les conditions générales de vente, outre leur aspect obligatoire, permettent d’assurer des relations commerciales saines et durables entre les professionnels en définissant un cadre précis entre le vendeur et l’acheteur.
Elles permettent notamment :
– de fixer un cadre de relation identique avec tous les clients. Il n’y a donc plus besoin d’avoir recours à des négociations à chaque fois, ce qui est un gain de temps considérable pour l’entreprise.
– de procurer des avantages pour l’entreprise en instaurant diverses clauses qui sont alors inscrites dans ces conditions (par exemple avec la clause attributive de compétence ou encore la clause compromissoire).
– de définir les conditions de règlement et les délais de paiement. Ces dispositions sont essentielles pour organiser la trésorerie de l’entreprise. Les conditions de recouvrement sont également fixées, permettant ainsi une transparence sur les procédures choisies par le fournisseur.
– d’assurer une sécurité pour le vendeur qui peut informer dès le départ l’acheteur, mais aussi l’acheteur potentiel, des différentes conditions dans lesquelles la vente ou la prestation de service sera réalisée ou se réalisera.
C’est également un moyen de clarifier tous les doutes que pourrait avoir un client.
Les conditions générales de vente comprennent a minima les éléments suivants :
Il est possible de différentier les conditions générales de vente selon les catégories d’acheteurs ou demandeurs de prestations de services ou de marchandises. La détermination des catégories de clients doit être réalisée par l’entreprise, sous sa responsabilité et doit définir avec précision chaque catégorie.
Il doit être mentionné les mêmes informations que pour les CGV mais attribuées à une catégorie de client sous peine de sanctions.
Selon la spécificité des services rendus, il est possible de convenir avec l’acheteur des conditions particulières de vente (CPV). Elles permettent d’adapter les conditions générales de vente à la suite de négociations.
Les CPV doivent contenir les obligations, modalités de vente ainsi que les avantages de l’opération entre le fournisseur et l’acheteur après négociations et prise en compte des CGV et CCV.
La communication des CGV doit être faite par le fournisseur, c’est à dire tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur.
Elles peuvent être exigées par l’acheteur ou l’acheteur potentiel mais il ne peut être reproché au fournisseur de ne pas lui avoir communiqué si celui-ci ne les avait pas demandées au préalable. Il est donc primordial d’en faire la demande préalable.
– Une amende du même montant peut être encouru en cas de non-respect du barème des prix et/ou des conditions générales de vente ainsi que le non-respect de l’indication des mentions obligatoires concernant le règlement.
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour vous assister dans la rédaction des conditions générales de vente, contactez le cabinet LEGISCAL, via la page de contact.
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (https://autorite-concurrence.nc) peut être saisie en cas de litige (selon l’article Lp. 462-5 du code de commerce de la Nouvelle-Calédonie).